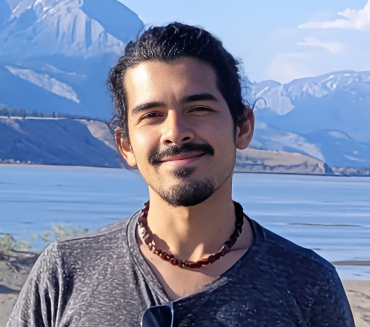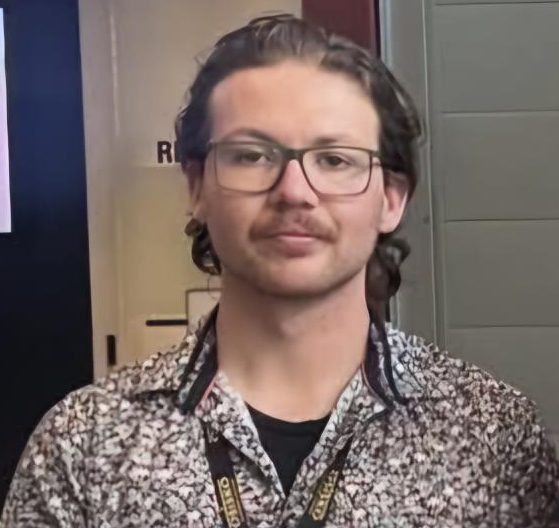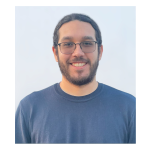Cartographie prédictive de la géologie du nord du Québec à l’aide de réseaux de neurones profonds
Le Canada contribue significativement à la production mondiale de minéraux et explore des ressources clés comme le lithium et les terres rares. Cependant, le nord du Québec reste sous-exploré en raison de son accessibilité difficile et d’une dépendance aux données historiques.
Analyse du cycle de vie de procédés miniers
Ma recherche se concentre sur l’évaluation du cycle de vie des processus d’extraction et de concentration du niobium et du tantale, deux métaux stratégiques utilisés dans diverses industries, notamment l’électronique et l’aérospatial. L’objectif principal est d’analyser et de quantifier les impacts environnementaux associés à ces processus, en considérant des étapes telles que l’extraction, le concassage, le broyage, la séparation magnétique, la flottation (sulfures, carbonates, pyrochlore), jusqu’à l’obtention d’un concentré final. Pour ce faire, j’utilise SimaPro, un logiciel spécialisé en analyse du cycle de vie, afin de modéliser les flux de matière, d’énergie et les émissions dans l’environnement.
Propriétés thermohydrauliques des roches et interactions géochimiques eau-roche dans un contexte de séquestration de CO2 appliquée à la géothermie
Dans un contexte de changements climatiques et de transition énergétique mondiale, les technologies telles que la séquestration géologique du CO2 et l’extraction de l’énergie géothermique à partir d’unités géologiques profondes gagnent en popularité. Le coût de forage de puits à ces fins est très élevé, mais dans certains cas, d’anciens puits de pétrole et de gaz pourraient être utilisés pour la séquestration du CO2 et la production d’énergie géothermique, ce qui rendrait ces technologies plus économiques. Pour s’assurer le fonctionnement optimal du système et prévenir la contamination de l’environnement, il est nécessaire de caractériser les changements dans les propriétés des unités réservoirs ciblées (porosité, perméabilité, conductivité thermique) résultant des interactions complexes entre les fluides et les roches.
Application de modèles d’apprentissage profond pour la cartographie prédictive de gisements de type sulfures massifs volcanogènes
Ma fascination pour les données géologiques et l’apprentissage automatique a pris forme lors de ma maîtrise en géologie structurale, où j’ai découvert à quel point ces approches pouvaient révéler des motifs cachés au sein des ensembles de données géologiques, structurales, géochimiques et géophysiques. Cet intérêt m’a amenée à explorer des méthodes plus efficaces d’extraction et d’analyse des données, une démarche qui oriente aujourd’hui mon projet doctoral. Je me concentre sur l’analyse avancée des données et la cartographie prédictive pour relever principalement des défis liés à l’exploration minérale, en particulier pour les gisements de sulfures massifs volcanogènes. En combinant les géosciences et l’apprentissage automatique, mon objectif est de développer des solutions innovantes basées sur les données, qui bénéficient à la fois à la communauté scientifique et à l’industrie, mais surtout, qui facilitent le travail quotidien des géologues.
Évaluation multi-échelle des caractéristiques hydrogéologiques et thermiques des milieux poreux pour comprendre le rôle des hétérogénéités en géothermie
Les systèmes géothermiques offrent une source d’énergie renouvelable pour chauffer des bâtiments en extrayant la chaleur de la Terre au moyen d’un fluide. Une configuration en boucle ouverte, où le fluide naturel est pompé dans un puits et réinjecté dans un autre une fois sa chaleur extraite, est particulièrement efficace, car le fluide peut se réchauffer sur une grande distance. Par contre, ce type de système nécessite la présence d’une roche perméable en profondeur. L’hétérogénéité de la roche affecte significativement la circulation du fluide ainsi que le transfert de chaleur. L’erreur induite lors de l’évaluation des propriétés rocheuses se reflète au final sur les prévisions de performance des systèmes géothermiques. Ce projet de doctorat vise à développer des méthodes pour caractériser les propriétés des roches ciblées à différentes échelles, à partir d’imagerie CT-scan (3D) et de mesures de conductivité thermique sur des carottes combinées à des données de forage existantes.
Volcanisme dans le Groupe d’Opémisca, région de Chapais, Sous-province de l’Abitibi
Intégration de données géochimiques dans un algorithme d’apprentissage profond basé sur la télédétection pour l’exploration minérale
Étude de la migration d’explosifs et de propulsifs dans des milieux poreux à travers des colonnes de sol enfouies soumises au climat canadien
Lors des 30 dernières années, des problèmes de contamination environnementale ont été identifiés mondialement à la suite d’entraînements militaires. Afin de préserver l’environnement, il est important d’étudier le devenir et le transport dans l’environnement des résidus de munitions générés à la suite de leur destruction ou utilisation dans les secteurs d’entraînement. Souvent, les techniques de laboratoire ne permettent pas de quantifier précisément le transport de masse des contaminants et les effets du gel/dégel saisonniers sur le bilan hydrique, tandis que les mesures de terrain à l’échelle des secteurs d’entraînement n’offrent pas le niveau de contrôle requis pour quantifier précisément les mécanismes de transport et de transformation des composés. Ainsi, une infrastructure de recherche composée de 12 colonnes enfouies et instrumentées a été construite à Valcartier (Québec) afin d’évaluer la mobilité des résidus de munitions dans des sols non saturés et exposés au climat.
Fragmentation dans les cônes de scories
Mon projet de doctorat porte sur la fragmentation magmatique, à l’origine de la production de tephras dans la plupart des éruptions explosives, pouvant se produire dans différents styles éruptifs, générant une grande variété de pyroclastes. Je travaille sur les cônes de scories, un type de volcan monogénique qui n’a connu qu’une seule éruption au cours de son histoire. Mes échantillons proviennent de Sunset Crater en Arizona, Cinder Cone en Californie (USA), Paricutín au Michoacan (Mexique), ainsi que d’un épisode paroxysmique de l’Etna en Sicile (Italie). Pour préparer et analyser les échantillons, j’utilise le protocole établi par Comida et al. (2022) et Ross et al. (2022) qui vise à standardiser toutes les études sur les tephras volcaniques. Le but du projet est d’établir un lien entre les morphologies, les textures des pyroclastes juvéniles de différentes granulométries, en fonction du style éruptif, de la hauteur de la colonne et de la dispersion des téphras.
Boursier PGQ 2023-2024
Géologie et structure du corridor de déformation Masères et son rôle potentiel sur les minéralisations aurifères, ceinture d’Urban-Barry (Abitibi)
Ce projet se déroule au centre de la ceinture archéenne d’Urban-Barry, au nord de l’Abitibi, où la plupart des minéralisations sont situées le long du corridor Masères. La minéralisation des gisements Windfall et Barry est contrôlée structurellement et les modèles actuels suggèrent un événement aurifère synmagmatique contraint à 2698 Ma par des dykes pré- et post-minéralisation. Toutefois, des travaux récents montrent que les structures des veines aurifères déforment aussi des roches post-2698 Ma, suggérant une minéralisation plus jeune. Une telle découverte aurait un impact majeur sur les modèles de formation des gîtes et les méthodes d’exploration. Le projet vise à caractériser le contexte géologique et structural régional pour tester l’hypothèse que des structures plus jeunes contrôlent la minéralisation, avec 3 objectifs: 1) établir un cadre lithostructural régional, 2) résoudre l’évolution du corridor Masères, 3) contraindre l’âge et la pétrogenèse des intrusions de la région.
Boursière PGQ 2024-2025
Étude des impacts de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures sur la qualité des ressources en eau
Ce projet vise à développer des méthodologies adaptées à différentes échelles spatiotemporelles permettant de valoriser les données existantes et d’orienter la collecte de données géochimiques dans l’avenir, afin d’améliorer les pratiques relatives aux études environnementales et plus spécifiquement à l’évaluation des impacts cumulatifs sur la qualité des ressources en eau. Différentes approches sont utilisées dans le but de discerner les impacts des activités industrielles versus la présence naturelle de composés dans les eaux souterraine et de surface, et dans certains cas, de comprendre les processus menant aux impacts observés. L’évaluation de ces effets combinés dans le temps et l’espace est réalisée, entre autres, via des analyses statistiques multivariées. Les résultats contribueront à améliorer les connaissances sur les interactions eau/roche ainsi que les échanges entre les unités géologiques profondes et peu profondes via des réseaux de failles ou des puits d’hydrocarbures.
Expérimentation d’une pompe à chaleur géohermique assistée par l’énergie solaire couplée à la biomasse pour le chauffage autonome
Mes recherches actuelles se concentrent sur le développement de solutions de chauffage autonomes pour des bâtiments isolés et hors réseau situés dans des climats arctiques ou subarctiques. Pour cela, j’exploite une combinaison de ressources renouvelables, notamment l’énergie géothermique, les panneaux photovoltaïques et le combustible de biomasse, afin de concevoir des systèmes de chauffage durables et performants.
Fragmentation du magma dans les maars
Mon projet de doctorat porte sur la fragmentation phréatomagmatique du magma. Je cherche à comprendre les forces qui brisent le magma lorsque l’eau et le magma se mélangent de façon explosive. J’étudie trois maars; Blue Lake Crater, Oregon (USA), Ukinrek, Alaska (USA), and Rotomahana (N-Z). Les maars sont des volcans de petit volume, monogénétiques, qui apparaissent lorsque le magma se mélange à un aquifère. Pour ce projet, j’utilise la méthode standardisée de Comida et al. (2022) et Ross et al. (2022) pour caractériser les cendres volcaniques produites par les maars. L’objectif de mon projet est d’utiliser la granulométrie, les composantes, la morphologie des particules juvéniles, leurs textures internes, et leurs caractéristiques de surface pour comprendre la fragmentation phréatomagmatique et comment elle est différente de la fragmentation magmatique.
Évolution tectonométamorphique de la Mauricie, partie centrale du Grenville, Québec, Canada
Mes recherches portent sur l’application de la pétrochronologie U-Pb sur la monazite minérale et le xénotime, ainsi que de la pétrochronologie Lu-Hf du grenat, afin de contraindre la chronologie du métamorphisme de haute intensité dans les ceintures orogéniques d’accrétion et de collision. Par exemple, j’applique ces techniques aux roches métapélitiques de la région de la Mauricie qui témoignent d’un métamorphisme du faciès amphibolite au faciès granulite durant l’intervalle de 1,2 à 1,0 Ga au cours de l’orogenèse du Grenville dans l’est de l’Amérique du Nord (coordonnées actuelles).
Quantification des effets d’échelle dans l’évaluation de la conductivité thermique : application aux systèmes géothermiques dans les Basses-Terres du Saint-Laurent et en Colombie
Ma recherche porte sur les effets d’échelle dans la mesure de la conductivité thermique du sous-sol et vise à améliorer l’extrapolation des valeurs issues du laboratoire vers des conditions représentatives du terrain. L’étude soutient la conception de systèmes de pompes à chaleur géothermiques grâce à l’élaboration de cartes de conductivité thermique du sous-sol : l’une principalement pour les systèmes verticaux à boucle fermée dans les Basses-Terres du Saint-Laurent (Québec, Canada), et l’autre pour les systèmes verticaux et horizontaux dans l’Est de l’Antioquia (Colombie). Cette dernière représentera la toute première carte de conductivité thermique réalisée pour l’Antioquia et pour la Colombie en général. La méthodologie intègre des travaux de terrain pour l’échantillonnage des sols et des roches, des analyses en laboratoire par balayage optique infrarouge et imagerie par tomodensitométrie, la modélisation numérique du transfert de chaleur, des simulations géostatistiques pour l’interpolation spatiale, ainsi qu’une évaluation technico-économique des systèmes de pompes à chaleur géothermiques à partir des cartes produites.
Interprétations des structures de la croûte profonde et du manteau supérieur dans le sud du Labrador et leur contrôle sur les minéraux critiques
Le gouvernement du Canada a récemment identifié 34 minéraux critiques qui jouent un rôle important dans la transition du pays vers une économie verte. Pour répondre à la demande croissante pour ces minéraux, il est nécessaire de mieux comprendre les facteurs influençant la distribution des gisements afin d’améliorer le ciblage de l’exploration et augmenter la découverte de nouveaux gisements en minéraux critiques et précieux. La majorité des gisements présentent des contrôles structuraux importants, et/ou sont localisés dans des intrusions, dans les deux cas souvent associés spatialement à des structures sous-jacentes dans la croûte profonde, voire dans le manteau supérieur. Mon projet vise à interpréter les structures du manteau supérieur et de la croûte profonde dans le sud de la province de Churchill et tester leur contrôle potentiel sur les gisements en minéraux critiques. L’étude financée par la Commission géologique de Terre-Neuve-et-Labrador s’appuie sur l’amélioration et l’interprétation d’images de données aéromagnétiques à haute résolution et gravimétriques satellitaires afin de cartographier les structures à différentes profondeurs. Le but est d’identifier les structures profondes les plus importantes dans le sud du Labrador et leurs contrôles potentiels sur les occurrences en minéraux critiques.

Contrôle structural et chronologie relative de la minéralisation aurifère du gisement Wesmeg-Nord associé à la mine Méliadine, Nunavut, Canada
Mon projet de recherche vise à comprendre les contrôles structuraux du gisement aurifère Wesmeg-Nord dans le district minier de Méliadine au Nunavut. Dans ce district, les minéralisations aurifères sont principalement associées à des formations de fer alors que le gisement de Wesmeg Nord est encaissé dans des roches volcaniques. C’est une différence notable qui soulève beaucoup de question et son étude aidera à affiner les modèles d’exploration régionaux et à exploiter plus efficacement ce gisement encore mal compris.